La job : l’argent n’a pas d’odeur.
Les voleurs sont
fascinants. À la fois héros et vilains, ils peuvent être des ordures totales
comme ils peuvent avoir un grand cœur, et lutter contre les injustices sociales
comme Robin des bois, ou Pancho Villa. Ils peuvent être des rebelles politiques
comme Bonnot, des rebelles sympathiques comme Papillon, des rebelles révoltés
comme Richard Blass, des rebelles séduisants et sauvages comme Mesrine. Ils
peuvent être authentiques ou d’implacables manipulateurs qui cachent sous leur
prétention de justiciers sociaux des délires psychopathes comme Jesse James.
Définitivement les voleurs sont de séduisants personnages pleins de
contradictions, d’ombre et de lumière.
Le casse
de l’année ou la connerie du siècle.
La richesse
symbolique et psychologique du voleur le cinéaste Pierre Falardeau l’a très
bien compris. Et c’est peut-être parce qu’il l’avait découvert chez le braqueur
Marcel Talon qu’il a décidé de raconter son braquage le plus fumant.
Il faut dire
que le projet de Talon était assez impressionnant. Avec ses complices il avait
décidé d’attaquer la succursale historique de la Banque de Montréal, celle
située au cœur du Vieux-Montréal. Loin d’un holdup traditionnel, Talon visait
un coup qui allait entrer dans les annales mondiales du crime. Le genre de « casse », qui aller reléguer
l’attaque du train postal de Londres en 1963 et le casse de la Société Générale
à Nice en 1976 au rang des petites arnaques. Pendant plusieurs mois, en plein
hiver, Talon et ses complices vivront dans les égouts, creusant jour après jour,
dans les pires conditions, un tunnel qui les mèneront vers la chambre forte de
la banque où les attendent 200 millions de dollars.
On connait
les relations orageuses entre Falardeau et Téléfilm Canada. Jamais le
réalisateur ne réussira à mettre sa vision du casse du siècle sur pellicule.
Toutefois il écrira un scénario que le talentueux dessinateur Forg vient d’adapter en bande dessinée
sous le titre de La job.
Même si
l’histoire de Marcel Talon était
déjà connue, grâce au film d’Érik Canuel Le dernier tunnel, Falardeau y apporte
un éclairage nouveau. C’est peut-être parce que le père d’Octobre a décidé de
nous présenter un Talon qui n’est pas qu’une victime enragée d’un système
carcéral qui en fait une bête féroce et violente. Sous sa plume Talon devient
un voleur d’une grande intelligence, méthodique, qui prépare point par point
son coup, qui prévoit toutes les situations possibles. Un joueur en parfait
contrôle qui trouve une réponse à tous les obstacles qui se dressent devant lui
et qui force l’admiration.
Si Falardeau
a créé un fabuleux huis clos, on peut dire qu’il trouve en Forg le véhicule parfait pour illustrer son thriller social. Avec
son trait minimaliste, tout en mouvement, le bédéiste dynamise le scénario de
Falardeau. Odeur pestilentielle, froid intense, neige violente transpirent
constamment des cases de Forg exacerbant les tensions entre ces criminels déjà
agressif à force d’être coincés dans la promiscuité d’un égout.
Une belle surprise.
La mort d’une idole.
J’adore
Nestor Burma, les romans et les bédés. J’adore ce Paris populaire d’avant les
années 50 dans lequel vit le héros de Malet. J’aime cet argot du milieu,
façon Auguste Le Breton, Michel Audiard, Georges Lautner ou José Giovanni. J’aime
ce parfum suranné d’une France qui n’existe que dans mes souvenirs.
J’aime Burma,
mais je me questionne sur son retour. Il y a quelque chose qui ne marche pas
dans ces reprises. Comme si la magie que Léo Malet créait, comme un orfèvre,
bouquin après bouquin, ne fonctionnait plus. Comme si Burma n’avait plus sa
place dans notre 21e siècle.
Nestor Burma
accompagne dans la capitale belge, son ami le comédien Guy Marchand invité au
Festival du film fantastique de Bruxelles. Entre deux représentations, Burma
accepte d’enquêter sur le cas de Léo Straum, condamné pour le meurtre de ses
parents et qui semble victime d’une erreur judiciaire ou d’une enquête bâclée.
Comme à son
habitude l’investigation de Burma devient vite un prétexte à DE fabuleuses
balades, ici Bruxelles, dans les quartiers les plus louches des grandes cités
accompagnées de ses réflexions aussi cyniques qu’hilarantes. Et c’est peut-être
ici que le bât blesse. Si les observations et la langue de Burma étaient authentiques
dans les écrits de Malet, ici elles semblent totalement déphasées et plaquées
artificiellement. Voir Burma arpenter le bitume de la Bruxelles d’aujourd’hui
en parlant l’argot des années 40 le transforme en un anachronisme ambulant.
Sans compter
que le roman est rempli de références inutiles à des chanteurs belges et à des
films importants. Une stratégie qui ne sert qu’à faire l’étalage de l’immense
culture générale de l’autrice. Et ne parle pas de l’utilisation récurrente de
termes comme « pédé » qui n’ont plus leur place maintenant… même dans les
polars.
Au lieu de transposer le Burma qu’on
connait dans notre univers actuel, Nadine Monfils aurait
dû en faire une version 2.0. Et tant pis pour les nostalgiques.
Une
déception, ça arrive à l’occaz.
Pierre Falardeau, Forg, La job, Gentilhomme
de fortune Inc.
Nadine Monfils, Nestor
Burma: Crimes dans les Marolles, French Pulp
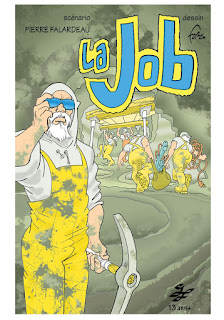

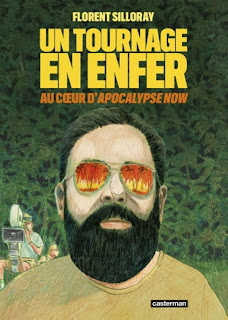
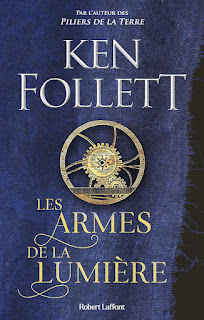

Commentaires
Publier un commentaire